espace pédagogique > actions éducatives > innovation pédagogique > échanger
harmoniser l’évaluation du collège au lycée pour mieux apprendre
mis à jour le 31/10/2024
Utiliser l’évaluation comme un indispensable dans le processus d’enseignement et d’apprentissage, c’est dans cette perspective que Cécile Astier, avec ses collègues professeures de SVT, s’interroge : comment et à quelles conditions la mise en place d’un modèle d’évaluation harmonisé de la 5e à la terminale peut-il permettre aux élèves de s’approprier leurs évaluations pour mieux progresser dans leurs apprentissages ?
mots clés : échanger, évaluation, enseignement spiralaire, échelles descriptives, autonomie, auto-évaluation
La réforme du collège, en 2015, a accéléré sa réflexion et son travail sur l’évaluation. Cette réforme, entre autres mesures, propose des cycles d’enseignement pour mieux prendre en compte la temporalité des apprentissages afin de permettre aux élèves d’atteindre le maximum de leurs potentialités ; ainsi les apprentissages ne sont plus envisagés et cloisonnés en années, mais en cycles qui relient école et collège (cycle 3) et qui permettent une continuité sur les trois années du cycle 4 (5e à 3e). L’élève a davantage de temps pour construire et montrer ses différentes maitrises des savoirs et savoir-faire. C’est une opportunité pour C. Astier de mettre au point un dispositif différenciant clairement l’évaluation formative et sommative. Dans celui-ci, l’élève peut choisir, selon là où il en est, une évaluation formative, “qui ne compte pas dans le bilan” ou une évaluation notée qui indique son niveau d’acquisition à un instant T.
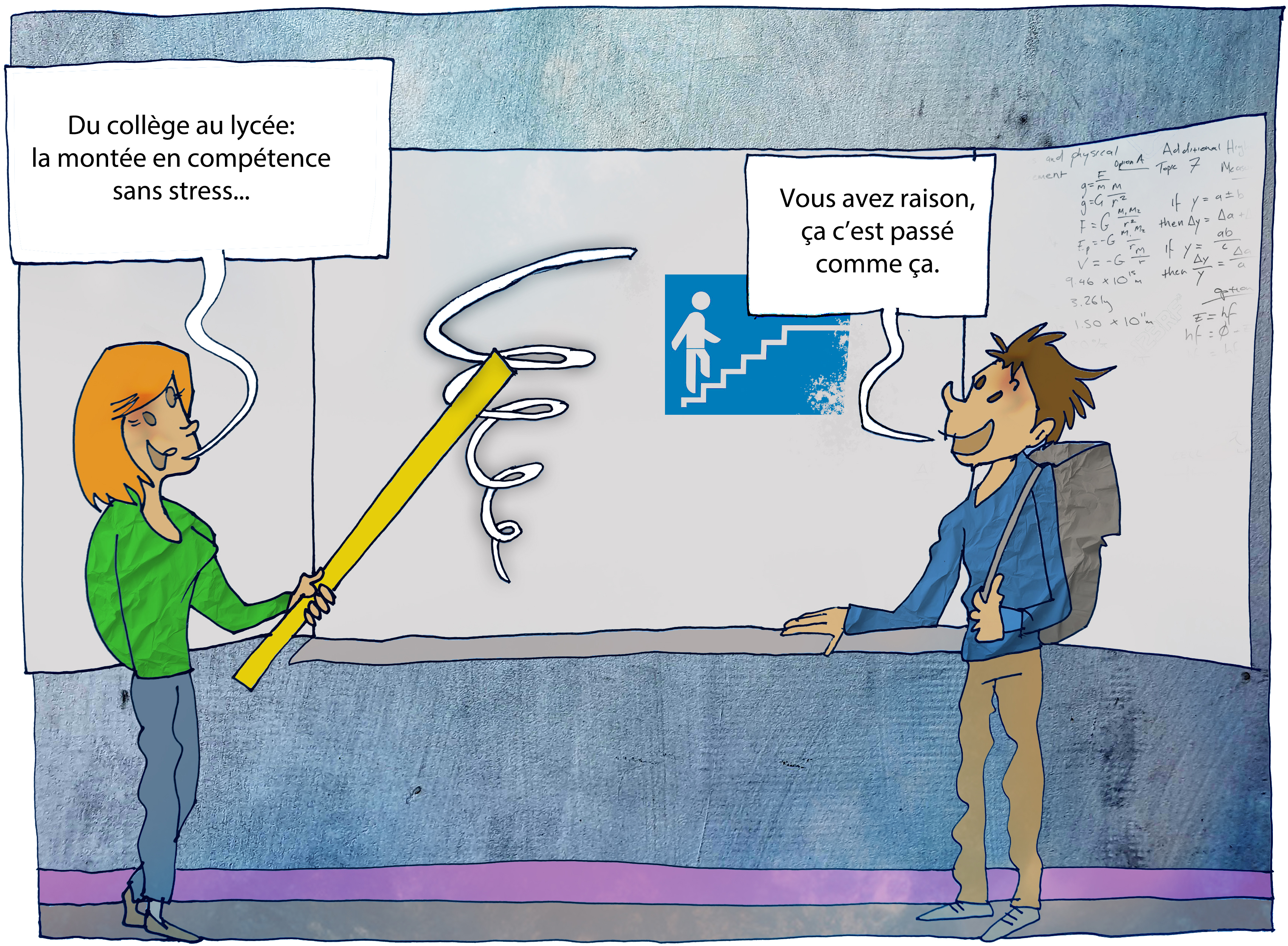
En 2016, nommée au lycée (sur la même cité scolaire), C. Astier mène un travail avec ses nouveaux collègues pour partager cette expérience de travail par compétences et ainsi construire ensemble une progression des connaissances et des compétences de la seconde à la terminale, spiralaire, et toujours en s’appuyant sur les échelles descriptives. Cela aboutit à la mise en place dès la seconde d’un outil d’évaluation équivalent à celui du cycle 4, avec la double volonté d’avoir un outil unique d’évaluation de la 5e à la terminale et néanmoins évolutif.
De par leur présentation, ces documents d’évaluation permettent aussi de laisser une grande place à l’auto-évaluation, par l’estimation individuelle de ce qui semble maitrisé ou non, comme l’explique C. Astier : “Je fais beaucoup d’auto-évaluation quel que soit le niveau et je l’ai toujours fait car je me suis toujours intéressée à la métacognition, au ‘comment apprendre à apprendre ?‘”. Il est difficile en revanche pour l’enseignante de donner une proportion exacte de la place laissée à l’auto-évaluation car elle avoue laisser un peu “libre court à son feeling selon les classes”. Mais au-delà de cette auto-évaluation, ces outils permettent à l’enseignante de développer la collaboration et la co-évaluation entre élèves, sans tomber dans le jugement ou la compétition. Avec les échelles descriptives, les élèves, s’ils sont invités à évaluer le travail d’un camarade, ne se prononcent pas en effet sur un chiffre qui donne un niveau, mais sur un progrès à faire, sur un levier à actionner pour améliorer un travail.
Avec le recul de plusieurs années, le bilan que C. Astier tire de cette méthode d’évaluation est positif. L’intérêt principal de l’outil est “d’avoir décidé d’un format qui ne change pas (de la cinquième à la terminale), et pour eux et pour moi. Il y a une continuité qui me permet d’expliciter de façon plus fluide le travail de compétences et l’évaluation”. L’outil favorise aussi dans la discipline et au fil des années et des différents enseignants d’avoir une vue d’ensemble sur les points forts, les points d’effort et la progression de chaque élève. Enfin cet outil développe un dialogue entre l’élève et l’enseignant : “on regarde ce qui peut être mis en place, sans figer la situation. Cela redonne du pouvoir à l’erreur et du pouvoir au jeune”.
Pour une équipe disciplinaire ou un établissement qui souhaiterait se lancer dans un projet de ce type pour harmoniser son système d’évaluation sur un cycle, voire davantage, C. Astier note que la première condition est de dégager du temps pour travailler et réfléchir ensemble : “il est nécessaire d’avoir des réunions de travail fréquentes pour harmoniser les pratiques, relire les préambules des BO et autres ouvrages, construire des outils communs”. Il est aussi préférable de disposer d’une équipe pédagogique assez stable même si l’arrivée d’un nouveau collègue peut être l’occasion de reprendre et d’approfondir le travail sur l’évaluation. C. Astier estime aussi qu’une personne qui accepte d’animer un peu le groupe de travail facilite la mise en place et le maintien d’une dynamique. Enfin, et c’est peut-être le plus difficile, une fois l’outil installé et le projet lancé, il faut éviter de cesser toute concertation et travail en commun car “il peut y avoir une sorte de dérive vers des anciennes pratiques et le projet devient de moins en moins un projet d’équipe qui se vit par tous”. En somme toujours rester en éveil et en mouvement selon l’adage de Nietzsche : “évaluer, c’est créer”.
S. Billon
contributeur(s) :C. Astier, Ensemble scolaire Saint-Benoît - Angers
innovation pédagogique - Rectorat de l'Académie de Nantes

 s'identifier
s'identifier
 portail personnel ETNA
portail personnel ETNA

