- Lycée tous niveaux
- analyse de pratique
- démarche pédagogique
- préparation pédagogique
- chef d'établissement
- enseignant
- classe
développer des pratiques de classe mutuelle au lycée
Dans l‘espace classe de Stéphanie Cailleau, professeure de SVT (sciences de la vie et de la Terre) au lycée Julien Gracq à Beaupréau, les élèves sont à l’œuvre. Le savoir n'est pas descendant, il se construit et il circule. Les élèves se questionnent, réfléchissent, bâtissent, élaborent et expliquent. La réflexion est collective, c'est ensemble que les élèves apprennent. Des îlots, de taille variable, favorisent les échanges. Des tableaux, nombreux, sont répartis dans l'espace, supports de la pensée en construction. L'espace est au service des apprentissages. L'enseignante expérimente, depuis la rentrée de septembre 2021, la classe mutuelle. Une bonne occasion de se demander pourquoi miser sur un tel dispositif ? Quel gain pour les élèves et l'enseignant-(e)?

Quels problèmes l'enseignante cherche-t-elle à résoudre en mettant en œuvre des pratiques de classe mutuelle ?
Les enjeux auxquels Stéphanie veut répondre en mettant en œuvre des pratiques de classe mutuelle dans son lycée sont multiples. Il s'agit d'abord de favoriser l'autonomie face à la démarche expérimentale, consciente qu'une autonomie plus grande de l'élève lui permettrait de dégager davantage de temps pour les élèves aux besoins plus importants, mais aussi de les rendre autonomes dans la cherche d'informations et de solutions, pour les préparer au post-bac. Dans cette perspective, Stéphanie souhaite améliorer la différenciation en favorisant le suivi du travail individuel. Ensuite, l'enseignante cherche à respecter le rythme d'apprentissage des élèves, tout en gardant la même exigence en termes de savoir et de savoir-faire. Enfin, il est question aussi de laisser davantage de place à la parole de l'élève.
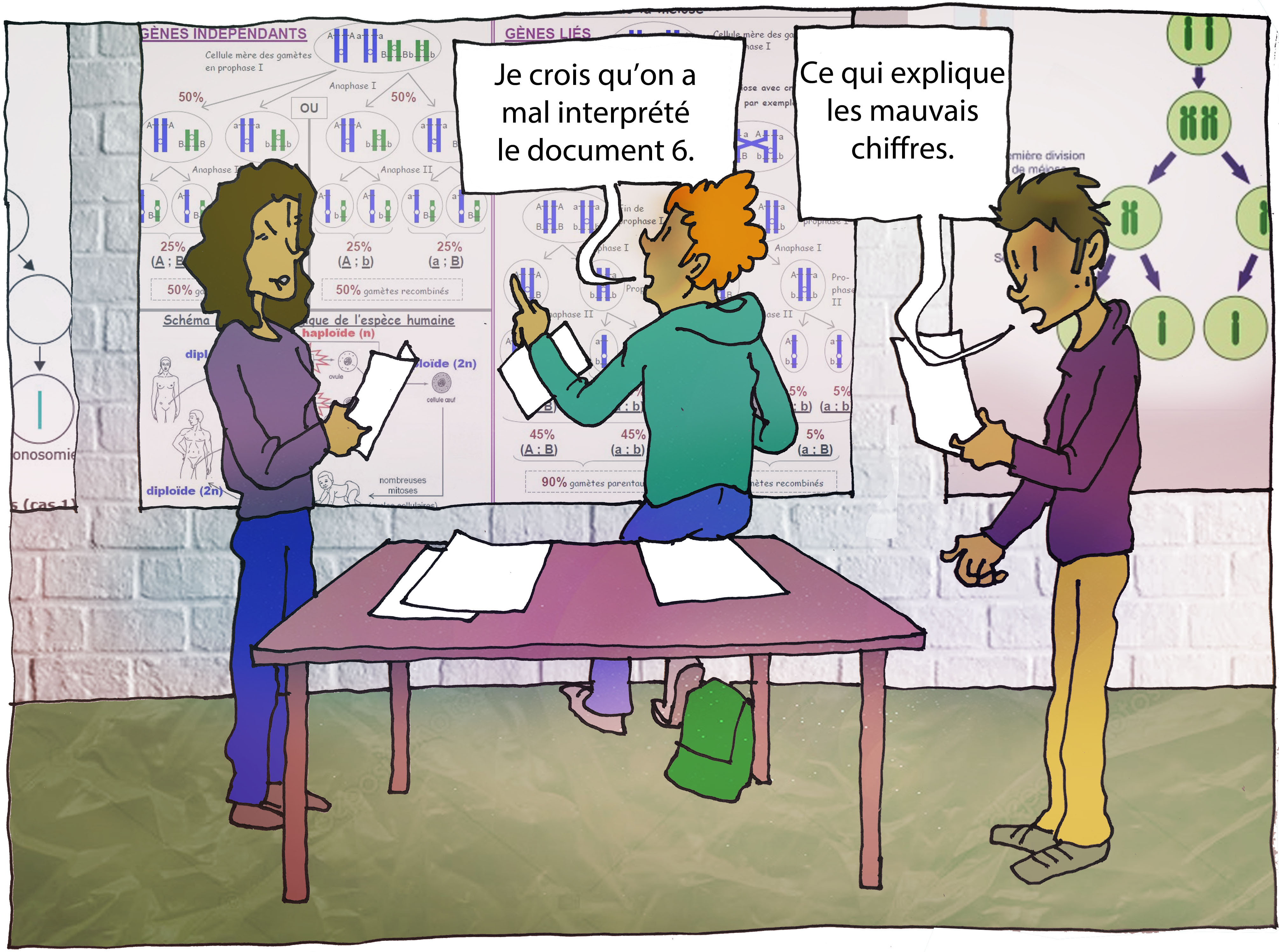
L'expérimentation porte sur l'enseignement de spécialité SVT de classe terminale. La classe mutuelle s'avère un bon moyen de provoquer la coopération qui se développe au gré des séances et les automatismes qu'acquièrent les élèves contribuent à la réussite du dispositif. En 2021/2022, lors de la première année d'expérimentation, la classe est composée de 35 élèves. Cette année, ils sont 16 en classe de terminale dans cet enseignement de spécialité.
 |
Au cours de la séance, une plus grande liberté est laissée à l'élève : il choisit sa place, les îlots ne sont pas fixes et peuvent varier au fil de la séance, ainsi que le matériel dont il a besoin, à l'instar de Hugo, Joan et Jordan qui sont installés dans une salle contiguë. Ils utilisent le vidéoprojecteur pour projeter les supports de travail et utilisent le tableau pour poser leur réflexion. Le tableau devient support d'échange. Ainsi, cette réflexion en construction se voit, on en garde la trace, ce qui permet la reformulation aux pairs ou à l'enseignante lors de son passage dans les groupes. C'est en effet lors de cette phase de reformulation et d'explicitation que l'enseignante valide le savoir dont elle est la garante.
 |
Les critères de réussites observés sont nombreux. Le bénéfice apporté par la multiplication des tableaux est double : visibles de tous, ils permettent aux élèves de visualiser les étapes de construction des autres groupes et ainsi aident à la progression. Le cheminement étant visible, c'est aussi un moyen pour l'enseignante de mieux identifier les besoins de ses élèves au cours de la séance. Elle peut ainsi apporter son aide mais aussi vérifier la justesse de la progression et valider avec les élèves leurs travaux. En effet, à partir du schéma, Stéphanie questionne pour approfondir la notion et s'assurer de sa compréhension. En fin de séance, un regroupement se fait autour d'un tableau présentant une réflexion aboutie. Un élève reformule à la classe les étapes de sa réflexion. Si besoin, l'enseignante ou les élèves corrigent ou complètent.
Les modalités d'apprentissages développées par Stéphanie font l'unanimité auprès de ses élèves, comme en témoignent Hugo, Joan et Jordan : “Chacun avance à son rythme. On va chercher des auto-corrections. Jordan est arrivé une activité après nous”, “On interagit, c'est plus motivant. On travaille mieux, il y a toujours plus de détails, plus d'éléments”. Clémentine, Lucie et Émeline partagent cet avis : “On peut aider les autres. Quand on est seul, c'est plus compliqué, on est livré à nous-même“. Quant à la flexibilité au sein de l'espace classe, “on est à l'aise, l'esprit plus détendu”, ajoute Noah, son voisin. Avis confirmé par Ryan, “C'est moins pesant”. Le mobilier à disposition, des poufs, des ballons ou des tables hautes, favorise ce bien-être propice aux apprentissages. Les élèves savent rapidement l'utiliser à bon escient.
Les savoirs sont mieux maîtrisés grâce à l'appropriation et la verbalisation. La mutualisation, “ça aide beaucoup à comprendre notre problématique” déclare Jade. De son côté, Ryan partage ce constat, “On a l'impression de mieux comprendre les documents”.
Du côté de l'enseignante, la méthode est efficiente, la construction des concepts et l'élaboration des schémas par l'élève, “c'est du temps de gagner pour la suite, la mise en place d'automatismes”. Quant à son programme, il faut s'imposer un rythme et revenir pour certaines connaissances à la transmission d'un savoir plus descendant. Un constat est parlant, “Je n'ai plus d'élève qui attend”, remarque Stéphanie. Tous sont dans la construction et trouvent réponse à leurs questions auprès d'un pair ou de l'enseignante. Enfin, si les préparations de séances demandent du temps, les modalités d'apprentissages permettent à Stéphanie une plus grande disponibilité pendant la séance, mise au service de l'observation et de l'accompagnement des élèves. Elle remarque aussi un regard plus positif des élèves sur l'évaluation, les élèves ne se comparent pas au niveau des résultats.
Devant ces constats positifs, Stéphanie Cailleau, soutenue par la direction de son établissement, souhaite bénéficier d'un accompagnement Cardie visant à intégrer cette expérimentation au projet d'établissement, mais aussi à l'amélioration du dispositif afin de favoriser sa mise en œuvre par les collègues désireux de développer ces pratiques.
Ainsi, à l'aune du dispositif observé dans la classe de Stéphanie apparaissent des principes clés pour se lancer, à savoir, l'aménagement d'un espace classe au service de la circulation des élèves et de la flexibilité, une situation favorisant la mutualisation et une séance cadencée sur un rythme ternaire (conceptualisation-explicitation, mutualisation, bilan) et un mot d'ordre, commencer humblement.
1. Vincent Faillet, professeur agrégé de sciences de la vie et de la Terre, auteur de La Métamorphose de l'école La métamorphose de l'école ; ressource sur la classe mutuelle disponible aussi sur le site du ministère de l’Éducation nationale de la jeunesse et des sports QUID #1 : la classe mutuelle - Archiclasse.
