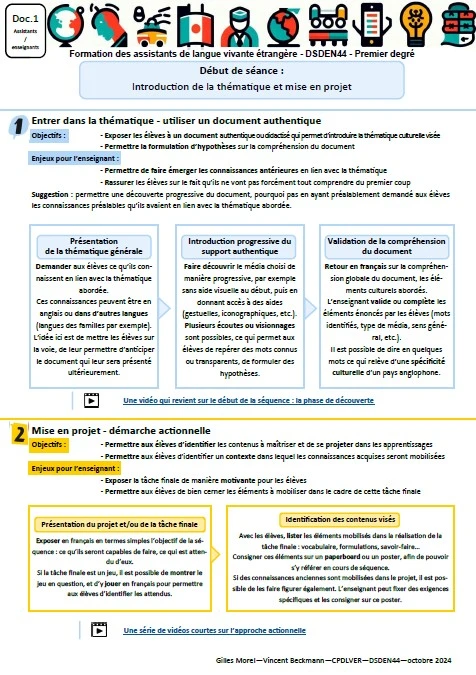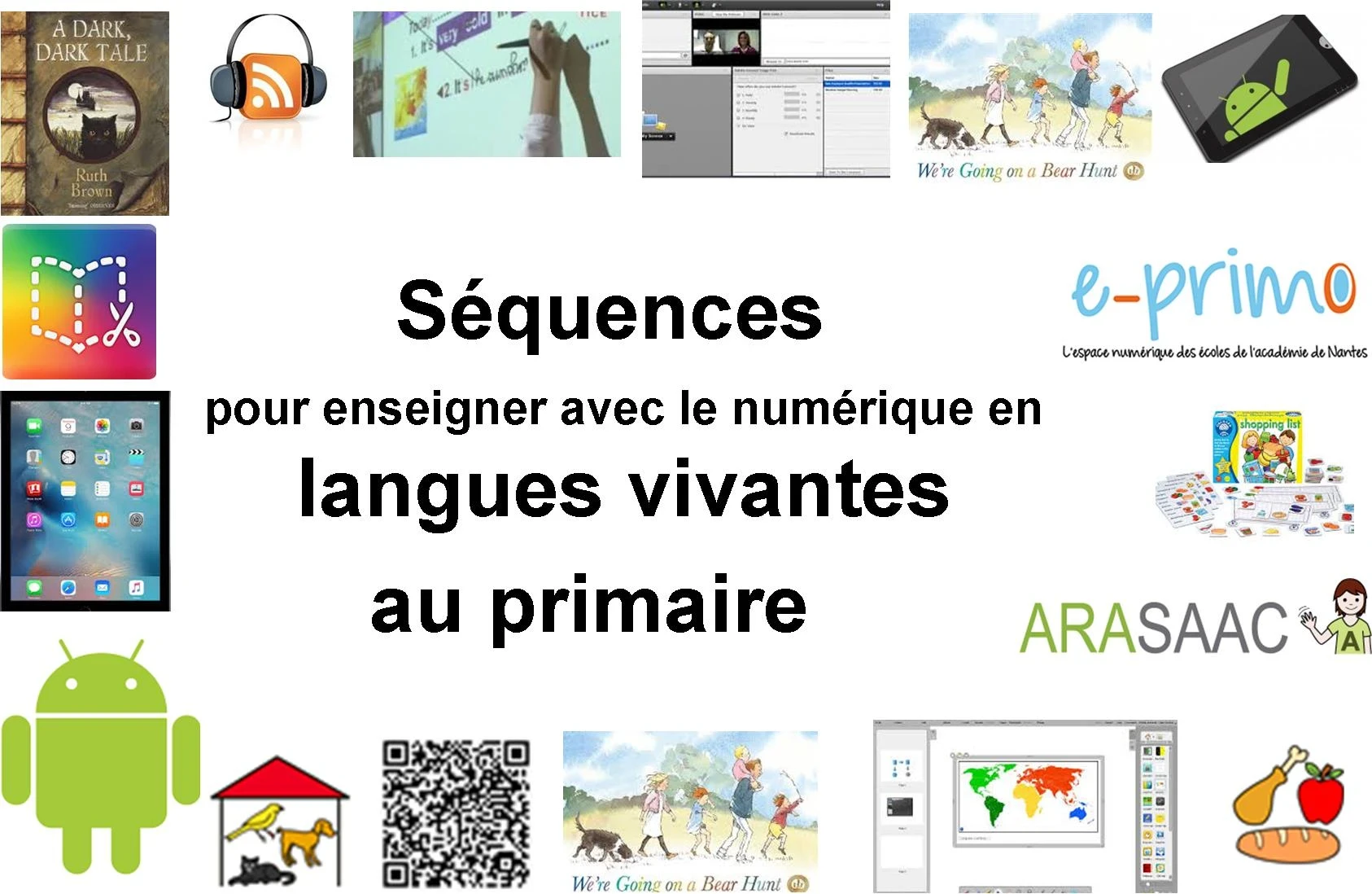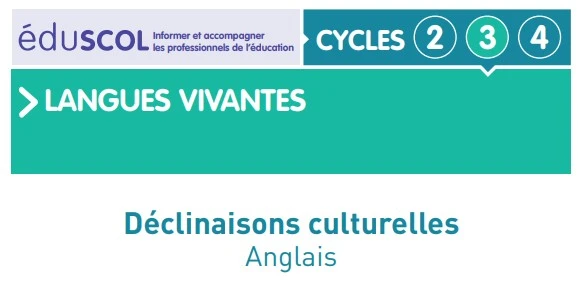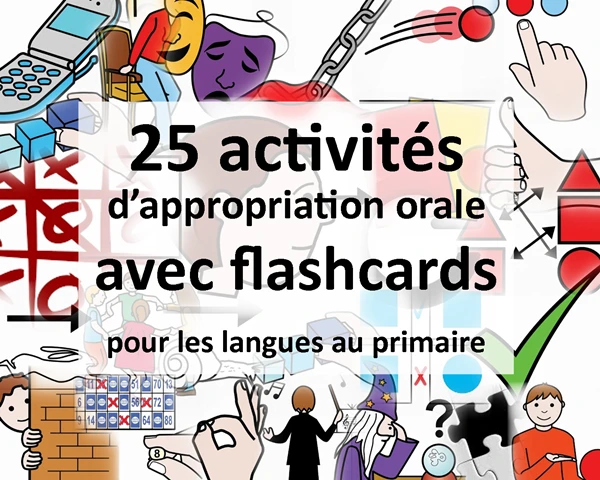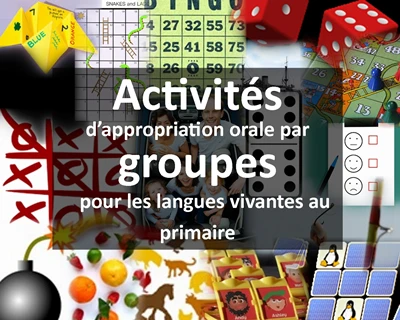L'approche générale
Ressources et conseils généraux pour concevoir des séances et séquences de langues
1- L'approche actionnelle
Les programmes de langues vivantes préconisent l’approche actionnelle. Elle consiste à mettre les élèves en situation de réaliser un projet concret (appelé « tâche finale »), qui donne du sens aux apprentissages.
Plutôt que d’apprendre du vocabulaire ou des structures « pour elles-mêmes », les élèves s’entraînent progressivement à mobiliser leurs connaissances pour atteindre un objectif : jouer à un jeu de société en anglais, préparer une petite saynète, réaliser une affiche, mener une chasse au trésor…

Cette démarche :
- motive les élèves en leur montrant à quoi sert ce qu’ils apprennent,
- permet d’organiser la séquence autour d’étapes intermédiaires claires,
- favorise la réutilisation et la combinaison de savoirs déjà acquis.
Voici quelques outils et supports pour faciliter le mise en place d'une approche actionnelle en classe :
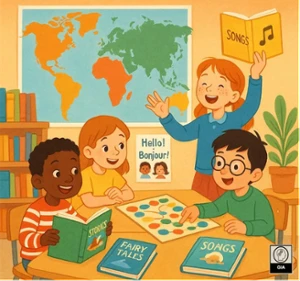
2- La dimension culturelle
L’enseignement des langues vivantes ne se réduit pas à l’acquisition de mots et de structures : il s’accompagne toujours d’une ouverture culturelle. Les programmes soulignent que chaque apprentissage linguistique doit s’ancrer dans une thématique culturelle, en lien avec l’univers et les centres d’intérêt des élèves.
En cycle 2, cela peut être la famille, la classe, les jeux, les chansons, les histoires… En cycle 3, les thématiques s’élargissent et invitent à découvrir d’autres aspects de la vie quotidienne dans les pays où la langue est parlée. Il ne s’agit pas de faire un cours d’histoire ou de civilisation, mais plutôt de montrer que des enfants ailleurs dans le monde vivent parfois comme nous, parfois différemment.
Intégrer cette dimension, c’est :
- donner du sens et du relief aux apprentissages,
- éveiller la curiosité et entretenir la motivation des élèves,
- développer l’ouverture et la tolérance face à d’autres façons de vivre et de penser.
Les ressources culturelles sont nombreuses et accessibles : albums, dessins animés, chansons, jeux traditionnels… Elles permettent d’ancrer la langue dans des situations concrètes et authentiques. Ainsi, la langue n’est jamais enseignée « hors sol », mais toujours reliée à des réalités culturelles qui enrichissent le projet actionnel.
Voici quelques outils et supports pour faciliter l'ancrage culturel des apprentissages en langues vivantes :
3- La progressivité des activités langagières
L’apprentissage d’une langue vivante à l’école repose sur une progressivité des activités langagières, qui accompagne l’élève dans son développement de la compréhension et de l’expression. Les compétences à acquérir par les élèves dans les différentes activités langagières sont décrites dans les programmes de langues vivantes.
Nous tenons à insister ici sur le fait que pour garantir l'apprentissage du plus grand nombre, il est judicieux de prendre son temps et de proposer des activités selon la logique suivante :

Une progression progressive et sécurisante pour l’apprentissage des langues vivantes
L’apprentissage d’une langue à l’école repose sur une progression des activités langagières qui accompagne l’élève dans le développement de sa compréhension et de son expression, conformément aux programmes. Cette démarche vous est présentée ici de manière succincte, mais est détaillée dans la sous-rubrique "organiser les apprentissages".
-
Compréhension orale : l’élève écoute et comprend sans produire immédiatement. Les activités, souvent non verbales (mimer, montrer, choisir un objet), permettent d’installer le vocabulaire et les structures dans un contexte significatif et de repérer les composantes phonologiques.
-
Production orale : une fois les acquis stabilisés, l’élève répète collectivement avec un modèle oral, puis reproduit individuellement et librement dans des situations variées.
-
Interaction orale : les élèves sont progressivement placés dans des situations de communication entre pairs, sous forme de jeux, dialogues ou tâches coopératives, mobilisant le vocabulaire et les structures déjà travaillés.
-
Introduction de l’écrit : dès le cycle 3, l’écrit est introduit uniquement pour consolider l’oral. Il sert à mémoriser et observer le fonctionnement de la langue, sans remplacer la priorité donnée à l’oral.
-
Traces et supports : les traces permettent de se repérer et de consolider les acquis. Au cycle 2, elles sont principalement visuelles ou sonores (images, pictogrammes, enregistrements). Au cycle 3, elles intègrent progressivement l’écrit, en appui d’un oral déjà acquis.
Cette démarche progressive sécurise les élèves et favorise les apprentissages pour tous, en valorisant la compréhension avant la production, puis l’interaction, et en privilégiant la qualité et la consolidation des acquis avant d’introduire l’écrit. Elle offre ainsi un cadre rassurant qui permet à chaque élève de s’engager avec confiance dans l’apprentissage des langues vivantes.